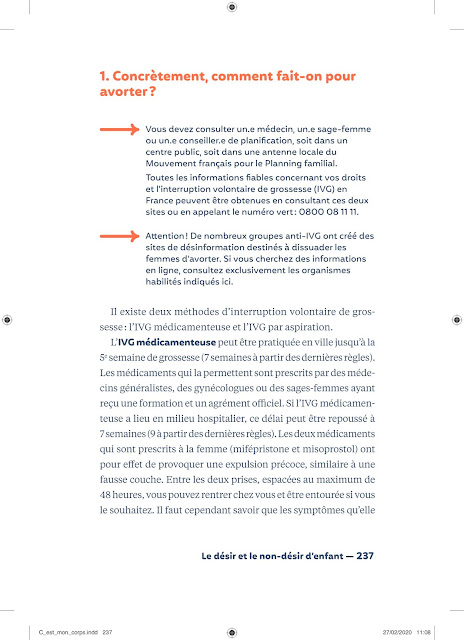A Betty
Je suis une lectrice. (Je rappelle qu'ici, j'utilise le féminin générique.)
Je lis à l'aventure, lorsque le livre (cueilli sur une table, une étagère, dans une conversation ou une autre lecture) me fait signe. Je ne lis pas parce que des "autorités" le prescrivent, mais parce que j'en ai le désir ou la curiosité. C'est le titre, ou le résumé, ou le sujet qui m'intéressent. Ce n'est pas le genre de la personne qui le signe.
Au cours de ma vie, j'ai lu beaucoup de livres écrits par des femmes. Des livres et des femmes de tous les genres. Je suis un une "lectrice transgenres (littéraires)" -- intertextuelle et intersectionnelle.
Je les énumère ici dans l'ordre approximatif de mes lectures. L'ordre est plus ou moins chronologique parce qu'il se mêle à l'ordre dans lequel ils me sont revenus - et par association, inévitablement : comme tout le monde, j'ai eu des "périodes" où je lisais plutôt des romans, plutôt des essais... et parfois plusieurs romans d'une même autrice ou d'un même auteur.
Il y a ici des livres connus de beaucoup, et d'autres que j'ai le sentiment d'être seul à connaître (ou de me rappeler). Je les mentionne de mémoire,. Il y en a certainement eu beaucoup d'autres. Mais si je me souviens de ces autrices spontanément, c'est parce que leurs livres ici mentionnés m'ont marqué, il y a plus de cinquante ans ou la semaine dernière. Ils ne m'ont pas touché d'abord parce qu'ils avaient été écrits par des femmes, mais par leur contenu ou leur écriture ou les deux. Et c'est seulement aujourd'hui que je réalise combien ils ont été nombreux. Les autrices sont de plus en plus nombreuses dans ma vie de lectrice, mais elles l'étaient déjà il y a très longtemps et l'ont été tout au long de ma vie.
Ces livres m'ont appris à lire, à imaginer, à écrire, à sentir et à penser. Et ça continue.
MW
NB : Je renvoie vers la page wikipédia (ou équivalente) de chaque autrice en français, sauf quand elle n'existe pas - auquel cas je renvoie à la page dans sa langue natale.
Les couvertures choisies en illustration sont celles des éditions que j'ai lues.
Je ne sais rien des autrices de ces livres. Je sais seulement que j'ai lu ces trois livres des dizaines de fois entre l'âge de 9 et 13 ans, et que j'ai toujours l'un des trois. Les autres sont probablement quelque part dans le grenier, dans ma maison d'enfance à Pithiviers. Je ne les ai sûrement pas jetés.
En traduction : Le Meurtre de Roger Ackroyd. Il se passe de présentation. C'est un roman magistral, l'un des cinq meilleurs d'Agatha Christie (1890-1976). Je l'ai lu en français d'abord, en anglais plus tard. Et relu plusieurs fois. C'est un roman souvent cité pour son retournement final mémorable, qu'il vaut mieux ne pas connaître avant de le lire pour la première fois. Mais il ne se réduit pas à ça. C'est la relecture qui montre la maîtrise de Christie, formidable conceptrice de puzzles criminels. Sur la liste des 100 meilleurs romans criminels dressée par la très britannique Crime Writers Association, ce roman occupe la cinquième place. Christie est une des autrices que j'ai le plus lues. Ses romans allient une construction narrative exemplaire à une grande finesse d'analyse psychologique. Ses énigmes (à commencer par Ackroyd mais aussi And Then There Were None ou Hercules Poirot's Christmas) sont souvent des crimes impossibles et elle est d'une érudition impressionnante - qu'il s'agisse de jouer avec des comptines traditionnelles (One, Two, Buckle my Shoe) ou de citer Shakespeare (Curtain). Et elle n'a pas peur des "cold cases" comme Five Little Pigs (Cinq petits cochons). J'ai appris la construction narrative grâce à elle, et je lui en serai éternellement reconnaissant.
En traduction : Le Miroir Obscur. Je l'ai lu en anglais à l'âge de 13 ans puis en français (je n'avais pas tout compris). Puis relu en anglais. C'est ce qui m'a fait découvrir que les traductions françaises des romans anglo-saxons raccourcissaient et caviardaient souvent le texte originel. C'est un roman policier psychologique, à tonalité fantastique (autour du thème du doppelganger) ; il est considéré comme un des grands classiques du genre. A l'origine, c'était une nouvelle, qu'Helen McCloy (1904-1992) développa pour en faire un roman.
C'est la première enquête de Lord Peter Wimsey, l'un des deux personnages principaux de Dorothy L. Sayers (1893-1957) ; elle en avait une autre, Harriet Vane, longtemps courtisée par Lord Peter, mais qui refuse de l'épouser car elle le trouve vain et a une vie bien à elle. Ils se rencontrent quand Harriet, qui étudie les poisons, est accusée d'avoir assassiné l'homme avec qui elle vit sans être mariée.
J'allais beaucoup au cinéma quand j'étais au lycée, et j'ai vite noté qui étaient les réalisateurs et les scénaristes de mes films préférés. Je n'ai pas manqué de remarquer que cinq films d'Howard Hawks (en particulier The Big Sleep/Le Grand Sommeil et Rio Bravo) avaient été écrits ou co-écrits par Leigh Brackett (1915-1978). Or, "Leigh" (comme Lee) est un prénom mixte. J'ai longtemps cru (parce qu'il s'agissait de "films d'hommes") que leur scénariste était un homme. C'est en 1973 aux Etats-Unis, en lisant la quatrième de couverture de The Long Tomorrow (en traduction : Le Recommencement), que j'ai découvert que c'était une autrice. Je n'ai plus regardé ces films de Hawks de la même manière.
Ce jour-là, j'ai abandonné un certain nombre de préjugés en réalisant qu'on pouvait être romancière de SF et scénariste de westerns ; et j'ai découvert une grande autrice de SF. The Long Tomorrow décrit les conflits entre science et obscurantisme dans un monde post-cataclysmique... Il n'est toujours pas passé de mode, à mon avis.
Vingt-cinq ans après The Big Sleep, Brackett adapta de nouveau Raymond Chandler dans The Long Goodbye (Le Privé, excellent film de Robert Altman) et son dernier scénario aurait dû être celui de L'Empire contre-attaque, mais sa contribution fut écartée par Lucas et Kasdan, qui écrivirent le script finalement tourné. Elle n'en figure pas moins au générique, et le film (très différent) que cela aurait pu donner est décrit sur cette page (en anglais).
Pendant mon année aux Etats-Unis, au début des années 70, j'ai lu beaucoup de comic books. En particulier le magazine parodique Not Brand Eech ! dans lequel les Marvel Comics se moquaient de leurs propres personnages. L'une de ses chevilles ouvrières était Marie Severin (1929-2018), l'une des rares dessinatrices du milieu à l'époque. D'abord chargée de la couleur pour tous les titres, elle se vit bientôt confier des personnages importants, comme Dr Strange, Iron Man ou Daredevil. Et elle créa l'aspect visuel de Spider-Woman en 1977. Autant dire que ses talents étaient nombreux.
***
Entre 1973 et 1981, pendant mes études de médecine, j'ai beaucoup lu. Encore plus qu'avant, je crois. C'est la lecture et l'écriture m'ont permis de tenir bon. A Tours, où je faisais mes études, je hantais deux librairies en particulier : la Boîte à livres (qui existe toujours) et la Librairie Franco-Anglaise (aujourd'hui disparue), tenue par un couple avec qui je m'étais lié d'amitié.
La libraire, Nancy, était originaire de Chicago, elle comprenait mieux que quiconque ce que j'avais pu vivre en Amérique et combien je me sentais déphasé en faculté de médecine. A une époque où je cherchais ma voie, tant sur le plan affectif que moral et politique, elle me fit découvrir trois livres qui m'ont profondément marqué.
D'Ursula Le Guin (1929-2018), j'avais déjà lu et été très marqué par The Left Hand of Darkness (La Main gauche de la nuit) quand j'étais au lycée. J'en parlais un jour à Nancy, et elle me sortit de derrière son comptoir l'édition cartonnée de The Dispossessed (en traduction : Les Dépossédés) qu'elle venait de rapporter d'un voyage à Chicago. "Je te le prête, c'est un cadeau qu'on m'a fait." Je l'ai lu en deux soirées et je l'ai relu une dizaine de fois pendant les années qui ont suivi.
Vingt-cinq ans plus tard, à Toronto, j'ai eu la chance d'être invité au Harbourfront Festival of Authors. (La Maladie de Sachs avait été traduit en anglais.) Ursula Le Guin était l'une des nombreuses invitées. Un matin, à la table commune où déjeunaient toutes les autrices et auteurs, elle s'est assise en face de moi. J'ai fait le tour de la longue table, j'ai mis un genou en terre et je lui ai déclaré ma reconnaissance de lecteur. Elle a ri avec indulgence.
Je ne savais rien de Doris Lessing (1919-2013) quand Nancy me tendit Le Carnet d'or, la traduction française (1976) de The Golden Notebook , publié en 1962 !!! Mais ce livre a changé ma vie d'écrivant. Il me montrait qu'on pouvait écrire un roman entretissant des textes d'écriture quotidienne (des journaux), une chronique historique et l'éveil d'une conscience militante. Au moment où je l'ai lu, j'avais grand besoin de repères de cette envergure. Ce n'est pas seulement un modèle de roman, c'est aussi un exemple d'itinéraire de l'âge adulte et de l'engagement.
Le troisième livre que Nancy m'a fait lire n'est pas moins important.
J'en avais appris l'existence, je crois, en lisant la revue Des femmes en mouvement, qui en recensa la publication.
Nancy m'expliqua l'historique de Our Bodies, Ourselves, compilé et composé par le collectif de femmes de Boston et initialement publié en 1970. Pour le petit groupe d'étudiant.es auquel j'appartenais, préoccupé.e.s de santé, de féminisme et de lutte contre le patriarcat (même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque), c'est devenu une bible.
L'édition papier a été complétée et remplacée par un site, passionnant et riche lui aussi : https://www.ourbodiesourselves.org
Quarante-trois ans après cette première édition française (que j'ai tellement lue qu'il a fini par tomber en lambeaux), une nouvelle version de Notre corps nous mêmes a été publiée en mars 2020, juste au début de la pandémie par les éditions Hors d'Atteinte. J'en suis très heureux, car elle est, à son tour, une somme indispensable d'informations libératrices.

J'ai lu The Daughter of time dans sa traduction française, La fille du temps juste après avoir fini mes études de médecine. J'ignorais l'existence de Josephine Tey (1896-1952), pseudonyme de l'autrice écossaise Elizabeth MacKintosh. Je m'attendais à lire un "simple" roman policier et j'ai découvert un roman historique d'une profondeur impressionnante. Cloué au lit par une fracture de jambe, l'inspecteur Alan Grant, héros de plusieurs romans de Tey, se met à enquêter sur... Richard III, immortalisé par Shakespeare dans une pièce qui le présente comme assoiffé de sang et de pouvoir au point d'assassiner ses deux neveux dans une tour sombre. A mesure qu'il recherche - grâce à une amie - des informations sur ce crime, Grant découvre que la vérité est tout autre que ce qu'on a inscrit pendant des siècles dans tous les livres d'école britanniques. C'est un "cold case" dans toute l'acception du terme, et sa conclusion est bouleversante car elle nous rappelle que ce que nous croyons savoir de notre histoire est parfois faux (les puissants s'en assurent) mais que lorsqu'une légende est tenace, il est toujours très difficile de rétablir la vérité.
A peu près à la même époque, j'ai poursuivi mon éducation féministe à travers des livres comme Du côté des petites filles d'Elena Gianini Belotti, qui montrait comment les parents modèlent (dans une certaine mesure) filles et garçons pour adopter des comportements genrés...
Au cours des années 70 et 80, j'ai lu beaucoup de livres des Editions des Femmes (on peut télécharger ici tous leurs catalogues depuis la création de la maison par Antoinette Fouque) tels Dans le mitan du lit, d'Evelyne et Claude Gutman, L'Age de femme et Psychanalyse et féminisme de Juliet Mitchell, Crie moins fort les voisins vont t'entendre, d'Erin Pizzey (ma première rencontre avec des récits de violences conjugales) et bien d'autres.
Parmi eux, les deux livres qui m'ont le plus marqué par leur écriture étaient signés Victoria Thérame.
Hosto-blues est le récit hallucinant de la nuit d'une infirmière intérimaire dans une clinique cancérologique. C'est le premier texte de littérature (très inspiré par l'expérience de l'autrice) que j'aie lu dont le sujet était la difficulté d'être soignante dans un univers hostile au soin. C'est un livre que je trouve toujours aussi magistral quarante-cinq ans après l'avoir lu. La Dame au bidule, publié quelques années plus tard, parle de son travail de chauffeuse de taxi, et il n'est pas moins impressionnant. Et après m'avoir éclairé sur le métier que j'apprenais et ne connaissais pas encore, il m'a appris beaucoup de choses sur un métier que j'ignorais complètement.
Autre livre de la même époque : Des Femmes dans la maison, Anatomie de la vie domestique, un livre collectif fascinant co-édité par Dominique Doan, Luce Pénot, Dominique Pujebet et Leïla Sebbar, dans lequel une dizaine de femmes témoignent de leur vie quotidienne dans tous ses aspects matériels ; il n'a pas, je crois, été réédité depuis sa publication en 1981. Mais on peut le trouver pour un prix acceptable chez les bouquinistes en ligne. Je l'avais perdu (ou donné) et j'en ai racheté un il y a quelques années. Je le feuillette et en lis des pages au hasard toujours avec le même plaisir.
Un autre livre m'a profondément marqué au début des années 80, c'est La Maternité en milieu sous-prolétaire de Marie-Catherine Ribeaud, psychologue militante d'ATD-Quart Monde. Je pense l'avoir lu parce que j'étais moi-même de plus en plus impliqué dans la mouvance du contrôle des naissances et des IVG, et parce que le fait que certaines femmes pauvres enchaînent les grossesses (et refusent de recourir à la contraception et l'IVG) soulevait des questions difficiles : il n'était pas question de qualifier ces femmes d' "obscurantistes" ou d'"hyperreligieuses" (la plupart ne l'étaient pas) et je voulais comprendre. Ce livre de sociologie m'a permis de le faire - et en tout cas de respecter un comportement et des situations que je ne pouvais pas, étant un homme d'une classe privilégiée, connaître de près. Avec Mother Nature (dont je parlerai plus loin), c'est un des deux livres de sciences humaines qui ont le plus profondément rectifié et éclairé mon regard sur la maternité.
Je lisais beaucoup pendant mes études de médecine. Et comme nombre de mes camarades progressistes de l'époque, je m'interrogeais sur le genre de pratique que j'allais adopter. J'ai lu beaucoup d'essais écrits par des médecins (des hommes pour la plupart) mais aucun de m'a aussi fortement impressionné que celui de Susan Sontag, La maladie comme métaphore. J'ignorais alors qui était Sontag, son importance comme critique et militante, et le fait qu'elle avait passé beaucoup de temps en France. (Je l'apprendrais plus tard en lisant un livre d'Alice Kaplan dont je parle plus loin.)
Un livre découvert par hasard en fouinant dans les librairies (ce fut longtemps ma principale activité de sortie, avec le cinéma) a eu une autre influence profonde sur mon écriture, tant par son contenu que par sa forme. C'est La Cause des Oies de Geneviève Mouillaud-Fraisse et Anne Roche. C'est un livre épatant, joyeux et désabusé, jeu de mémoires de deux militantes et entreprise de (dé)construction aléatoire, à partir du jeu de l'Oie.
J'ai lu le livre à la fin des années 70 et il m'a tellement plu que je l'ai gardé précieusement. Un jour, en 1999, lors d'un colloque consacré à Georges Perec auquel j'assistais, j'attends mon tour à la cafétéria près d'une femme avec qui je noue la conversation. J'apprends qu'elle connaît bien Philippe Lejeune, l'organisateur du colloque ; que nous avons tous deux contribué à son livre collectif sur le journal intime, Cher Cahier... (1990) et qu'elle se nomme Anne Roche. Je m'exclame : "LA Anne Roche ? Celle de La Cause des Oies ?" Ce fut le début d'une longue amitié. (Et de beaucoup de lectures réciproques.)
Au début des années 80, alors que je travaillais dans une revue médicale, je me suis abonné à une revue nommée Nouvelles Nouvelles. Claude Pujade-Renaud et Daniel Zimmermann, qui enseignaient, écrivaient et animaient la revue ensemble, se proposaient de publier dans chaque numéro des plumes "confirmées" (parmi lesquelles beaucoup de femmes) et des écrivant.e.s dont ce serait le premier texte. C'est dans cette revue que, grâce à eux, j'ai pour la première fois publié une nouvelle sous mon pseudonyme.
Je me suis rapidement lié à Claude et Daniel, qui sont devenus mes marraine et parrain en écriture. Leur affection et leurs conseils me furent un précieux soutien pendant que j'écrivais mon premier roman, La Vacation. Après en avoir lu le manuscrit, Claude m'offrit son premier livre, dont j'ignorais l'existence, et qu'on ne trouvait plus. La Ventriloque est le récit intime d'un avortement. J'ai été profondément touché en le lisant et j'ai remercié le sort de ne pas me l'avoir fait lire avant : je n'aurais probablement pas osé écrire mon roman. Après l'avoir lu, j'ai inscrit en épigraphe trois phrases de Claude.
Adolescent, j'étais lecteur de Pilote. A la fin des années 70, je me suis mis à lire les magazines contestataires créés par des dessinatrices et dessinateurs transfuges de la BD "classique". En particulier, les revues des Humanoïdes Associés. C'est dans l'une de ces revues, Ah ! Nana, qualifiée de "féministe et licencieuse", et qui n'eut qu'une dizaine de numéros, que je découvris Chantal Montellier, dont je lus de nombreux albums au cours des vingt ans qui suivirent. En 1998, dans un salon du Livre, j'eus l'occasion de prendre un café avec elle en attendant mon train de retour. Comme je lui exprimais mon admiration (et mon envie) après la lecture de son "Poulpe" (La Dingue au Marrons) elle en parla à l'éditeur de Baleine, qui me proposa d'en écrire un à mon tour. Et c'est grâce à Chantal Montellier, que j'avais beaucoup lue, que j'ai écrit et publié mon premier roman policier, Touche pas à mes deux seins.
Bien avant la publication de mon premier roman, je lisais déjà des livres P.O.L. J'en ai lu beaucoup d'autres depuis, et comme la maison publie beaucoup d'autrices, j'ai naturellement lu beaucoup de livres depuis 30 ans de Leslie Kaplan, Danielle Mémoire, Marguerite Duras, Camille Laurens, Marie Darrieussecq, Marie Dorsan, Marianne Alphant, Marie Depussé, Emmanuelle Bayamack-Tam et Rebecca Lighieri, Rossana Campo, Nathalie Azoulai, Elsa Boyer, Hortense Cornin, Stacy Doris, Elisabeth Filhol, Emmanuelle Pagano, "Sa femme", Jocelyne Desverchère, Madame L., Lise Charles... et j'en oublie, car je les cite de mémoire.
Je m'arrête ici pour le moment, car plus j'avance, plus il m'en revient...
Pour lire la suite, cliquez sur ce lien : https://wincklersblog.blogspot.com/2021/01/jai-appris-le-monde-dans-des-textes.html
(A suivre)